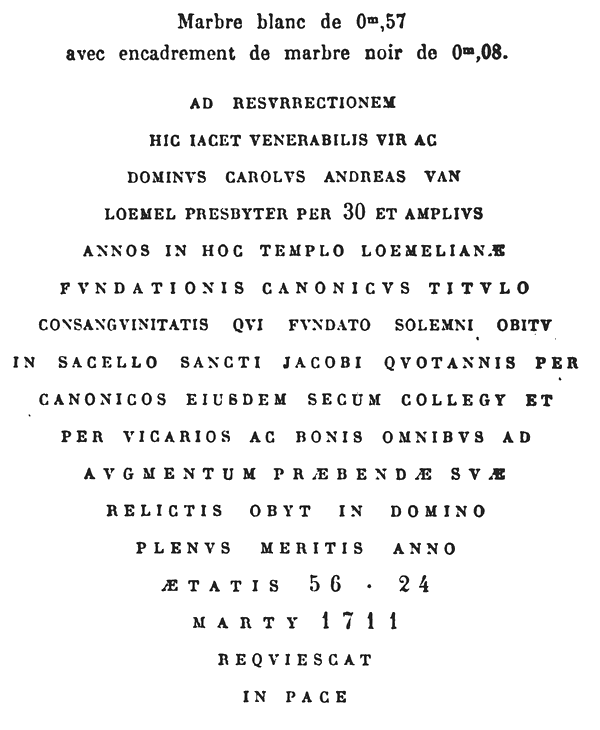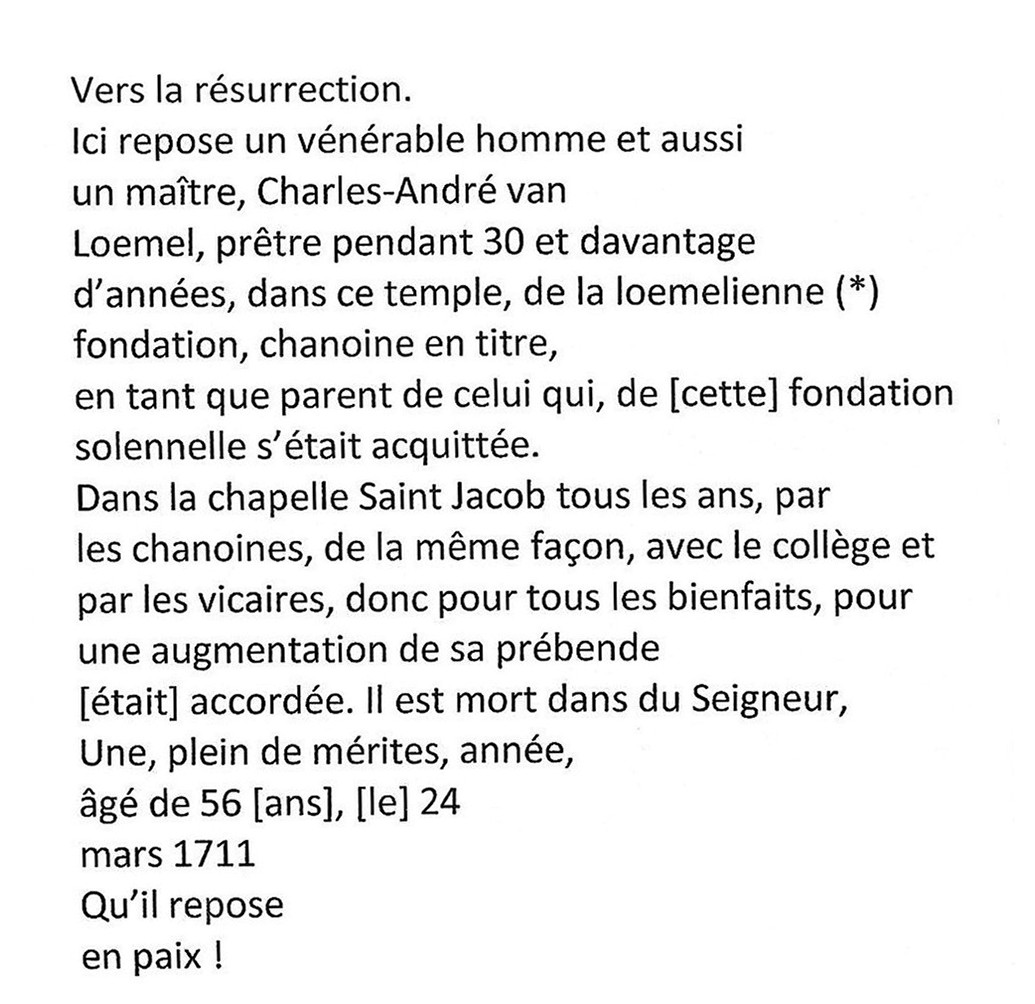Précisions à propos des donateurs
Le prie-Dieu du donateur masculin est orné d’armoiries qui se blasonnent : d'or (ou d'argent), au lion de sable, armé et lampassé de gueules (11) à la bordure du même (12),
timbré d’un casque d’argent grillé, liseré et couronné d’or, assortis de lambrequins d’argent et de sable avec, au cimier : un buste de maure habillé et tortillé d’argent.
Ces armes sont effectivement celles de la famille de Fiennes (Artois, Brabant), comme le propose G. Coolen (13) en s’appuyant sur la description du Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (14).
Toutefois, je suis moins d’accord avec le membre de la famille du Bois qu’il propose de reconnaître dans le portrait du retable. En effet, le chanoine identifie Jean-Baptiste du Bois (15), chevalier (16),
seigneur de Droogenbosch et de Mambre, gouverneur de Weert. Or ce Jean-Baptiste a vécu à la toute fin du XVIe siècle : il est fait chevalier en 1587 et est mort vers 1602,
ce qui est parfaitement incompatible avec le style du tableau, qui appartient au premier tiers du XVIe siècle. En outre, G. Coolen précise que son Jean-Baptiste s’est marié à Marie-Angéline de Ligne,
or la femme qui fait face au donateur sur un autre volet du polyptyque ne peut pas être une Marie, puisque la sainte patronne est identifiable, par ses attributs, à Catherine d’Alexandrie.
Enfin, G. Coolen ne tient pas compte non plus du fait que le prénom composé « Jean-Baptiste » est relativement rare au Moyen Âge, et que Jean le Baptiste est d’abord associé au prénom Jean (17).
Or, si l’on remonte un peu la généalogie de Fiennes, de la branche des seigneurs d’Euchin (18), on trouve un Jean (19) qui est beaucoup plus compatible avec le donateur du retable.
Il s’agit de Jean III du Bois (1445-1496), seigneur d'Esquerdes, d'Annequin, de Noyelles et de Raincheval, qui s’est marié, en premières noces (20), avec Catherine de Caumesnil (1440-1479), dame de Tenques (21).
On notera néanmoins qu’il pose toujours un problème de datation. En effet, Jean III est mort à la fin du XVe siècle et le style du retable indique une réalisation dans le premier tiers du siècle suivant.
Jean III ne peut en avoir commandité la réalisation quinze ou vingt ans après sa mort.
On peut proposer deux hypothèses : soit il a été effectivement commandité par Jean III à la fin de sa vie, on notera d’ailleurs que le donateur et sa femme sont figurés âgés sur le retable.
Ce dernier aurait été exécuté plus tard et sur une période assez longue.
Mais cette hypothèse est fort peu probante, compte tenu de l’écart important de temps entre la mort du donateur et l’exécution de l’œuvre.
Plus probable serait une commande posthume, par l’un des enfants du couple. Or il s’avère que leur fils ainé, Jean IV du Bois (147.-153.), chevalier, seigneur du Bois, de Tenques, de Béthencourt, de Caumesnil,
d’Esquerdes, capitaine, conseiller et chambellan du Roi, premier baron d’Elnes (22), fut aussi brièvement grand bailli de Saint-Omer de 1487 à 1488 (23), et il est
mentionné parmi les bienfaiteurs de la table des pauvres de la paroisse Sainte-Aldegonde à Saint-Omer. Il épouse Louise de Crèvecœur (1473-1533) (24) en 1493.
Jean IV a un frère, Antoine de Fiennes (vers 1469 - 7 avril 1537), évêque de Béziers en 1490, et abbé commendataire de Saint-Lucien de Beauvais en 1499.
Il a aussi un demi-frère Charles du Bois, du remariage de son père avec Jeanne du Bois, et une demi-sœur, Barbe du Bois, qui fut mariée à François, 1er comte de La Rochefoucauld (+ 1516).
On ne connaît pas les dates précises de Jean IV, mais La Chenaye Desbois dis que son demi-frère Charles, héritier féodal de Jean IV et d’Antoine, « testa le 3 avril 1548 » (25)
en faveur de l’ainé de ses fils, Eustache de Fiennes (26). Sachant qu’Antoine est décédé en 1537, on peut légitimement situer le décès de Jean IV dans les mêmes années, ce qui
lui aurait laissé le temps de commander le retable audomarois.
Cette œuvre a donc pu être commanditée par Jean IV du Bois d’Esquerdes en souvenir de son bref passage au bailliage de Saint-Omer, pour être placée en bonne vue dans la basilique.
Une iconographie énigmatique
L’iconographie des panneaux du côté des donateurs est en effet, de prime abord, assez énigmatique.
Georges Coolen en a tenté une lecture peu convaincante. Il propose de voir sur le panneau du donateur une scène de prêche, avec le père du donateur figuré par l’adolescent assis sous la chaire.
Dans le panneau de l’évêque, il se contente d’identifier une scène de guérison miraculeuse, opérée par la statue du saint qui se trouve au-dessus de l’autel.
Pour le panneau de la donatrice, notre très-catholique chanoine (27) voit dans cette « scène de violence », une illustration de la Révolte des Gueux, qui a sévi
dans nos régions à la fin des années 1566, et qui a été largement commentée par divers auteurs audomarois. Il suggère que le seigneur qui pose son pied sur la gorge du jeune « malandrin »
allongé au sol serait le duc de Parme. Par ailleurs, Coolen ne semble pas identifier la donatrice pour ce qu’elle est. Il n’y voit qu’une femme âgée en prière, « accompagnée d’une jeune
personne qui semble tenir une épée » et qui porte une couronne sur la tête. Enfin, sur le dernier panneau, il voit une scène de guérison miraculeuse, qu’il attribue à nouveau à la statue
du saint figurée sur l’autel.
Reprenons un peu tout cela.
Proposition d’interprétation
Je n’ai pas encore réussi à identifier clairement la référence de cette iconographie, mais ce qui est certain c’est qu’elle ne correspond à rien de mentionné dans les vies d’Omer et de Bertin. Je vous propose donc, en l’attente de mieux, une lecture faite de rapprochements et de probabilité, mais qui reste pour l’heure à l’état d’hypothèse. Avec l’espoir que ces thèmes trouveront un écho chez l’un ou l’autre lecteur de cette petite contribution.
Récapitulons les épisodes figurés sur les panneaux du polyptyque audomarois.
- Sur le panneau du donateur on voit un magistrat qui condamne un jeune homme à quitter ses parents pour suivre un homme en armure et revêtu d’un manteau pourpre.
- Le panneau de la donatrice et celui de l’évêque représentent l’exorcisme d’un jeune pèlerin opéré par un jeune religieux en présence d’un évêque.
- Sur le dernier panneau, le miracle est posthume, une femme dont le bras était en écharpe, se trouve guérie par le truchement de trois cierges placés au pied de la statue d’un évêque.
Ces trois évènements trouvent un écho particulier dans la vie d’un des saints les plus populaires de l’Europe médiévale, et qui a fait l’objet d’une dévotion particulièrement forte dans notre région si l’on en juge par le nombre important d’églises qui lui y sont dédiées. Il s’agit de Martin, évêque de Tours.
La vie de ce dernier est mise par écrit dès 397 par un de ses disciples, Sulpice Sévère (v. 360-v. 420) (28), et on y trouve relaté plusieurs événements qui peuvent êtres rapprochés des scènes du polyptyque audomarois.
Ainsi, au second chapitre de la vita est fait état du service militaire du jeune Martin, obligé par la loi romaine de consacrer plusieurs années de sa vie au service armé à la place de son père
qui était tribun des soldats (29). Il me semble que ce pourrait être cette scène qui est figurée sur le panneau du donateur. On y voit en effet un représentant de la loi intimer l’ordre au jeune homme de
suivre l’homme au manteau rouge, possible allusion au paludamentum des généraux de l’armée romaine. Le problème que pose cette interprétation c’est que le père de Martin souhaitait que son fils prenne
les armes, or sur le tableau audomarois il semble regretter le départ de son fils. Les deux panneaux du côté de la donatrice, qui illustrent un exorcisme opéré par un
jeune clerc, pourraient faire référence à un passage du premier livre de la Vita sancti Martini, qui relate qu’Hilaire de Poitiers, souhaitant le faire entrer dans le clergé, proposa à
saint Martin de devenir exorciste, après que ce dernier eut refusé le diaconat pour lequel il ne se sentait pas assez digne. Malheureusement le texte ne donne pas d'exemples précis d'exorcisme
pratiqué par Martin de Tours, il dit juste que ce dernier avait une emprise sans précédent sur les démons.
Enfin, le dernier panneau pourrait faire état d’un miracle posthume du saint, opéré par le truchement de trois cierges qui avaient brûlé sur le tombeau de saint Martin, et que Grégoire de Tours avait
rapportés dans son église. Cet épisode est relaté par Grégoire dans le Livre des miracles de saint Martin : « en retournant, nous emportant trois cierges pour avoir quelque chose qui participât à
la bénédiction du bienheureux tombeau. Il serait trop long de dire combien de miracles se manifestèrent sur les fiévreux et autres malades par la cire de ces cierges » (30). Mais Grégoire ne détaille pas les miracles opérés par les cierges. Le peintre a donc dû improviser. Mais il est possible qu’il se soit inspiré d’un autre chapitre des Miracles
de saint Martin, qui raconte comment une femme dont le bras s’était contracté en fut guérie par la vertu du saint (31).
Si mon hypothèse est la bonne, on constatera qu’il manque la scène de la charité de Martin, qui est pourtant de loin l’iconographie la plus connue et la plus répandue de l’histoire de l’évêque de Tours.
Cela pourrait s’expliquer par l’incomplétude du retable. En effet, les quatre panneaux conservés devaient très certainement se refermer pour cacher la composition centrale, celle-ci n’étant dévoilée que
pour les principales fêtes du saint. Le reste de l’année, les panneaux refermés offraient la scène classique du calvaire à la dévotion des fidèles. Dès lors, on peut émettre l’hypothèse que la
composition centrale figurait le saint partageant son manteau avec un pauvre.
Pourquoi saint Martin ?
Comme je l’ai dit plus haut, saint Martin jouit d’une faveur immense au Moyen Âge. Dans notre région, il faut rappeler que la légende d’Omer veut que l’évêque des Morins ait fait édifier sur la terre de Sithiu,
avant même l’église de la Vierge, une chapelle en l’honneur de saint Martin de Tours (32).
Depuis, les églises dédiées à Martin sont particulièrement nombreuses dans la région : Audruicq, Bergues, Beuvry, Brias, Bruay-la-Buissière, Carvin, Campagne-lès-Wardrecques, Croix-en-Ternois, Elne (33),
Eterpigny, Frencq, Guines, Laires, Landrethun, Lespesses, Looberghe, Nortkerque, Nordausques, Ruminghem, Samer, Saint-Martin au Laërt, Saint-Martin d’Hardinghem, Saint-Martin lés Boulogne,
Therouanne, Zouafques, Zutkerque… et bien sûr, Esquerdes, qui a donné son nom à la branche de la famille de Fiennes à laquelle appartient le donateur figuré sur le retable qui nous intéresse (34).
Ce retable s’y trouvait-il avant d’arriver à Notre-Dame de Saint-Omer ? Possible mais rien n’est moins sûr. Il a aussi pu être installé dans la chapelle de la collégiale Notre-Dame de Saint-Omer
dédiée à l’évêque de Tours. C’est celle qui se trouvait immédiatement sur la gauche en entrant par le portail occidental, ou à droite en entrant par le portail nord (35).
références :
(7) L’agneau, le vêtement de peau de chameau et le type barbu du personnage ne font en effet pas de doute. Voir Élisabeth Weis, « Johannes der Täufer », dans Lexicon der Christlichen Ikonographie, 7, 1974, c. 164-190.
(8) Peter Assion, « Katharina von Alexandrien », dans Lexicon der Christlichen Ikonographie, 7, 1974, c. 289-297.
(9) Jacques de Voragine, Légende Dorée, trad. par J.-B. M. Roze, Paris, Garnier Flammarion, 1967, tome II, p. 386-395, ici p. 392.
(10) Sébastien Louis Saulnier, « Légende Dorée des Artistes », Revue britannique, 6e série, tome 5, Paris, 1846, p. 136-163, ici p. 148. L’absence de la roue se remarque en particulier dans les œuvres qui figurent son mariage mystique.
(11) La bordure de gueules étant la brisure introduite par Henri I de Fiennes, puiné de Robert de Fiennes, lorsqu’il initie la branche des seigneurs du Bois d’Esquerdes.
(12) La bordure de gueules étant la brisure introduite par Henri I de Fiennes, puiné de Robert de Fiennes, lorsqu’il initie la branche des seigneurs du Bois d’Esquerdes.
(13) Coolen, 1975, p. 273-274.
(14) J. S. F. J. L. de Herckenrode, Complément au Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, Gand, 1865, v. I, p. 217-233.
(15) Coolen, 1975, p. 275-276 – Voir aussi Isidore de Stein d’Altenstein, Annuaire de la Noblesse de Belgique, deuxième année, Bruxelles, 1848, p. 292.
(16) Jean-Charles Joseph de Vegiano, Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, 1e part., Louvain, 1760, p. 77.
(17) Ce prénom commence à devenir plus courant à la Renaissance, surtout en Italie, à Florence, Gène et Milan, dont il est le saint patron, et dont les habitants ont l’habitude de le nommer par son attribut : il Battista, qui va peu à peu être intégré au prénom : Giambattista, pour le différencier de Jean l’évangéliste.
(18) Héritiers Robert de Fiennes, premier seigneur d’Euchin, second fils d’Enguerrand de Fiennes, baron de Tingry et de Ruminghen, lui-même fils d’Eustache II de Fiennes. Voir François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, tome VI, 2e éd., Paris, 1773, p. 387-391.
(19) Ce prénom apparait dans la lignée des seigneurs du Bois d’Esquerdes avec Jean I, trisaïeul de Jean IV, mort à Azincourt, qui épouse Jeanne (alias Isabeau) de Lens, dame d’Annequin (morte en 1392). Leur fils, Jean II, écartèlera les armes du Bois d’Esquerdes avec celle de Lens : écartelé d’or et de sable. Voir la généalogie de la maison de Fiennes établie par Etienne Pattou, sur http://racineshistoire.free.fr/LGN.
(20) Sa seconde épouse fut Jeanne du Bois, dame de Bourse.
(21) La Chesnaye des Bois, VI, 1773, p. 390 – qui cite d’après le père Anselme de Sainte-Marie, Histoire des grands officiers de la Couronne, tome VI, p. 167.
(22) Justin Deschamps de Pas, « Notes pour servir à la statistique féodale dans l’étendue de l’ancien bailliage et de l’arrondissement actuel de Saint-Omer » tome 1, MSAM, 33 (1921-1924), p. 225 et 403.
(23) La Chesnaye des Bois, VI, 1773, p. 390. Voir E. Liot de Nortbécourt, « Épitaphe du Maréchal d’Esquerdes par Jean Molinet », BSAM, 1856, p. 632-659, p. 649 et Pagart d’Hermansart, « Histoire du bailliage de Saint-Omer 1193-1790 », tome II, MSAM, XXV, 1899, p. 267, qui donne pour blason à Jean du Bos : d’argent au lion de sable, armé et lampassé d’azur. Il précise en note que « le Ms. Des Lyons de Noircarme, donne : armé et lampassé de gueules. – La Chesnaye des Bois, t. II et Haudicquier de Blancourt, Nobiliaire de Picardie, p. 50, présentent le lion armé et lampassé de sinople, et il est indiqué comme armé et lampassé d’azur dans les Mém. des Antiq. De la Picardie, t. VII, 2e série, &882, p. 358. Ce sont là, croyons-nous, les véritables armoiries conformes à celles données par d’Hozier, Arm. gén. de 1696. Artois et Picardie, éd. Borel d’Hauterive, pp. 4, 6, 19. Tencques et Berles, Canton d’Aubigny (Pas-de-Calais) ».
(24) Saint-Omer, BA, ms. 891, tome II, p. 291.
(25) Abbé Collet, « Biographie chronologique des Barons et seigneurs d'Elnes depuis le XVe siècle », Mém. Soc. Académie. Boulogne, 28 (1917), p. 24. Voir aussi Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des pairs, des grands officiers de la Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens barons du Royaume... continuée par M. Du Fourny. Troisième édition, revue, corrigée & augmentée par les soins du P. Ange & du P. Simplicien, Paris, 1730, p. 174, qui signale des quittances allant jusque 1509, et indique que Jean IV porte le sceau écartelé de Fiennes et de Lens instauré par son ancêtre Jean II (voir supra note 13).
(26) La Chesnaye des Bois, Dictionnaire de la Noblesse, tome VI, seconde édition, Paris, 1773, p. 390.
(27) Le Chanoine Coolen est connu pour ses positions antiprotestantes. Il s’est particulièrement penché sur l’expression anglicane de la Religion Réformée.
(28) Sulpice Sévère, Vie de saint Martin, éd. Jacques Fontaine, Paris, Cerf (Sources Chrétiennes, 133-135), 1967-1969 ; Sylvie Labarre, « La composition de la Vita Martini de Sulpice Sévère », Vita Latina, 171 (2003), p. 102-120.
(29) Jacques de Voragine, Légende Dorée, trad. par J.-B. M. Roze, Paris, Garnier Flammarion, 1967, tome II, p. 336-346, ici p. 336.
(30) La vie de Saint Martin évêque de Tours, avec l'histoire de la fondation de son église, et ce qui s'y est passé de plus considérable jusqu’à présent, Tours, Jean Barthe & Hugues Michel Duval, 1699, p. 22 (Saint-Omer, Ba, inv. 3567).
(31) Les livres des miracles et autres opuscules de Georges-Florent Grégoire, évêque de Tours, revus et collationnés sur de nouveaux manuscrits et traduits pour la Société de l'histoire de France par H.-L. Bordier, 4 tomes, Paris, Renouard, 1857-1864, ici tome II, livre 3, chap. 46, p. 250-251.
(32) Emmanuel Wallet, Description de l’ancienne cathédrale de Saint-Omer, Saint-Omer et Douai, 1834, v. 1, p. 6.
(33) Au cœur de la baronnie du donateur du polyptique, l’église Saint-Martin d’Elne conserve encore un culot sculpté avec les armes écartelées de Fiennes et de Lens de la famille du Bois d’Esquerdes, avec un cimier en forme de vol de griffon. Épigraphie du Pas-de-Calais, V-7, Arras, 1899, p. 371 (canton de Lumbres).
(34) Camille Enlart, « Notice sur l'église d'Esquerdes », MASAM, 31 (1912), p. 77-89 ; Sophie Léger, L'église Saint-Martin d'Esquerdes. Un témoin des temps romans et gothiques, Fauquembergues, 2017.
(35) Wallet, Description de l’ancienne cathédrale de Saint-Omer, 1834, v. 1, p. 34 - Wallet précise aussi, p. 32, que la chapelle dite des Wissocs, qui s’ouvre dans la troisième travée du bas-côté sud, aurait été tardivement dédiée à l’évêque Martin.